

DÉCARBONATION DU SECTEUR DE L’AÉRONAUTIQUE
RÉSUMÉ DU RAPPORT DE L’OPECST
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a produit en mai 2024 un rapport et des recommandations sur un secteur à impact climatique : l’aéronautique. Jean-François Portarrieu, député, et Pierre Médevielle, sénateur, en ont été les rapporteurs.
L’impact de l’aviation sur le climat
Depuis le XXe siècle, l'aviation a rapidement évolué. Le trafic mondial devrait croître de plus de 3% par an, surtout en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Depuis 1973, l’intensité énergétique a baissé de 79 %, mais le trafic a augmenté de 1 236 %, entraînant une hausse de 176 % des émissions de CO2. Le secteur représente 2 % à 3 % des émissions mondiales, comparable à l'Allemagne. Sans action, cette part augmentera.
Prise de conscience des acteurs du secteur
Les acteurs aéronautiques ont pris des mesures pour réduire les émissions. L'OACI a fixé des objectifs de croissance neutre en carbone pour 2020 et « net zero » pour 2050. L'UE a adopté le Pacte vert en 2019 et le paquet climat « Fit for 55 » en 2023. En France, la loi Climat et résilience de 2021 a conduit à une feuille de route pour décarboner l’aérien.
Les technologies et innovations pour la décarbonation
L'électrification et l'hydrogène présentent des limitations intrinsèques, notamment poids des batteries et difficulté de stockage de l'hydrogène, dont de plus la sécurité (safety) est difficile à assurer. On peut cependant imaginer des avions hybrides combinant électrique et thermique et permettant de transporter des dizaines de passagers sur des centaines de kilomètres à moindre coût.
Il y a aussi des marges de progression dans la conception des avions et de leurs moteurs, notamment allègement et meilleur rendement. Des espoirs sont également placés dans l'optimisation des vols et du roulage.
Les carburants d’aviation durables (CAD)
Leur rôle est essentiel pour remplacer le kérosène fossile.
Deux types existent : biocarburants (carbone et hydrogène organiques) et e-carburants (carbone capturé et hydrogène décarboné). On vise une part de ces derniers dans les carburants de 2% en 2025 et 70% en 2050 ; leur prix élévé pourrait augmenter le prix des billets de 35%.
Pour répondre au besoin, la France doit augmenter significativement sa production d'électricité décarbonée car la biomasse ne suffira pas.
RECOMMANDATIONS
Développer la production de carburants décarbonés : créer une filière de synthèse, intensifier la R&D sur la capture du CO2 et l’électrolyse, développer l’électricité décarbonée ...
Soutenir la recherche pour l’aviation décarbonée : renforcer la coopération, soutenir la R&D sur l’électrification, explorer les applications militaires, approfondir la recherche sur les effets non-CO2 ...
Préparer les infrastructures : adapter le contrôle aérien, inciter les aéroports à tarifer les émissions de CO2, établir un calendrier pour la décarbonation des opérations au sol et adapter les aéroports régionaux ...
NDR : Situation mondiale actuelle
Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la politique de Donald Trump qui voudrait interdire tout ce qui pourrait défavoriser les carburants fossiles. Un rapport prévu pour juin 2025 abordera le sujet global de l'énergie ( domestic energy resources) où “domestic” reste un terme ambigu, pouvant représenter les ménages ou le pays tout entier.
L’OPECST 
est l’un des rares offices communs entre le Sénat et l’Assemblée Nationale. Il a pour m i ssion d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d’éclai- rer ses décisions. Il intervient par exemple sur la sûreté nucléaire et la radioprotection en France, sur « agriculture et science », ou sur l’utilisation de l’IA dans les activités de recherche... C’est un domaine où de jeunes ingénieurs de l’armement peuvent intervenir en apportant un regard scientifique dans des domaines régaliens.
Auteur










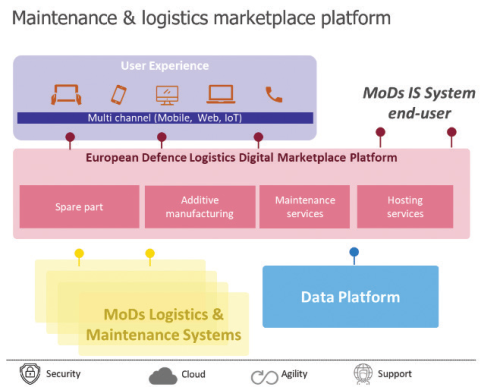
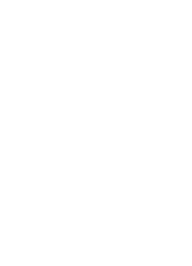
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.