

POLITIQUE MINISTÉRIELLE EN FAVEUR DES PME
(PRESQUE) 30 ANS DÉJÀ !
Pour savoir où aller, il est toujours important de savoir d’où l’on vient. J’ai ce mantra bien en tête à chaque prise de poste. Les archives permettent d’apprécier l’histoire passée… pour autant que les archives nous laissent entrevoir ledit passé.
À mon arrivée en poste dans ce qui était encore le service des affaires industrielles et de l’intelligence économique en septembre 2023, j’ai pu mettre la main sur la lettre de mission du contrôleur général des armées JOUAN datant de 1998 signée du ministre de la Défense de l’époque. Conscient de l’impact économique territorial (et politique) de l’activité de ces entreprises, Alain RICHARD créa la « mission ministérielle PME », censée être temporaire, dont l’objectif était de « tirer les enseignements de différents cas d’espèce », pour « rétablir la confiance avec les PME-PMI ». Deux ans plus tard, la mission ministérielle était pérennisée et une instruction ministérielle érigeait en 2001 les principes d’un « engagement de service » en faveur des PME : ce qui était une sensibilité politique trois ans auparavant se transformait en action résolue de l’administration, action qui n’a fait que se renforcer depuis. Une attention particulière a ainsi été portée aux délais de paiement, avec une performance du ministère inégalée dans l’administration (14 jours en moyenne pour les PME), et près de 40 000 sollicitations par an, de la demande d’information basique à la sollicitation de médiation.
Un seul être vous manque…
Onze ans plus tard, en 2012, le ministre Le Drian a souhaité que les grands donneurs d’ordre s’engagent à ses côtés dans cette action. Aucun hasard dans tout cela : la politique de verticalisation du ministère (ou de responsabilisation des maîtres d’œuvre dans les programmes d’armement, ce qui revient au même) avait conduit le ministère à être moins directement connecté aux sous-traitants. Une action coordonnée avec les maîtres d’œuvre devenait donc une nécessité, vu de l’État.
En effet, la perte de l'un des savoir-faire critiques peut à la fois pénaliser un ou plusieurs programmes d'armement portés par la DGA, et compromettre l'exécution d'un contrat pour un ou plusieurs maîtres d'œuvre industriels.
Vu des maîtres d’œuvre, cela a pu être vu comme de l’interventionnisme dans des relations inter-entreprises, tout du moins au début.
Le ministère a ainsi mobilisé les grands donneurs d’ordres sur différents volets :
- l’accès aux marchés de défense, par un partage d’information adapté ;
- la mise en place de relations équitables et partenariales entre sous-traitants et donneurs d’ordre, en particulier sur le partage (ou la rémunération) de la propriété intellectuelle ;
- l’identification et l’accompagnement des fournisseurs critiques ;
- le soutien des fournisseurs dans leur dynamique export, notamment par une meilleure visibilité des prospects export.
Les crises comme un révélateur
Les crises récentes (COVID, guerre en Ukraine) ont agi comme un révélateur, d’abord du besoin d’une plus grande transparence avec les maîtres d’œuvre sur la connaissance de la chaîne de sous-traitance. Même si cela paraît désormais évident pour tous, et même si des conventions sont en place depuis 2012, la crise du COVID a rendu les échanges plus naturels sur l’identification et l’accompagnement des sous-traitants en difficulté. Tout le monde admet que la relation État-industrie est plus efficace quand il s’agit d’une relation Etat plus industrie, lorsque les actions sont combinées.
Une illustration, parmi d’autres, est la cyberrésilience. L’objectif de l’Etat et de l’industrie est le même : un meilleur niveau de cybersécurité de toute la chaîne de sous-traitance. Sensibilisation, accompagnement, coercition. Sur ces trois volets, l’Etat et l’industrie mènent des actions combinées.
Sensibiliser : une administration qui explique la norme (« dire la loi »), ce n’est pas suffisant. Décrire les risques non plus. Seuls des témoignages de cas réels ont un impact sur les entreprises, soit par d’autres chefs d’entreprises, soit par la DRSD, acteur de confiance. Ceci pour les inciter à rentrer dans un parcours de cybersécurisation. Tant que ce premier pas n’est pas fait, le reste ne viendra pas.
Accompagner : soutenir via des dispositifs d’aide n’est pas suffisant non plus. Mettre en relation, dire « comment faire » en plus de « dire la loi », c’est se mettre à la place des entreprises.
Coercition : est-ce que la « peur du gendarme » dissuade ? Pas plus dans ce domaine que dans d’autres. En revanche, ne plus être dans un panel fournisseurs, oui. Le « bon goût » de la norme est son aspect partagé, connu de tous (même si imposé parfois).
Je n’ai pas pris cet exemple par hasard : la cyberrésilience est nécessaire à la montée en cadence, notamment pour les entreprises qui fabriquent du matériel qui sera utilisé en Ukraine, et ce, pour des raisons évidentes.
Une autre illustration est la visibilité sur la commande publique et les perspectives d’exportations. Le ministère affiche la loi de programmation militaire comme preuve d’une visibilité pleine et entière sur 7 ans de la commande publique envers le tissu industriel. Mais ce n’est pas si simple… Si les grands maîtres d’œuvre voient bien leurs perspectives de commandes (41 Rafale marine et 137 Rafale Air en dotation en 2030, 10 systèmes de drones aériens Marine en 2030, je vous renvoie au rapport annexé de la LPM), est-ce que les sous-traitants arrivent à se projeter dans des intentions de commandes ? Rien n’est moins sûr, surtout si ces programmes feront l’objet de mises en compétition de plusieurs fournisseurs par les maîtres d’œuvre. Sur cet aspect aussi, l’Etat a besoin des maîtres d’œuvre en relais d’information : quel sera le planning des commandes ? Sur quel nombre de commandes export le fournisseur doit-il se projeter, et sur quel calendrier ? Les réponses sont dimensionnantes pour ajuster sa cadence de production et investir le cas échéant.
Plus forts, ensemble
En conclusion, la politique ministérielle mise à jour en juillet dernier a rendu deux approches complémentaires : la première consistant à inciter les maîtres d’œuvre dans l’attention portée à leurs fournisseurs, la seconde militant pour être au contact des entreprises. Et permettre au final l’application du grand principe – non mathématique – : « 1+1=3 ».
La politique ministérielle en faveur des fournisseurs, et en particulier les PME, est le fruit de presque trente ans d’actions et de volonté politique, politique dans laquelle le ministère a choisi un rôle de tiers de confiance.

Après un début de carrière au centre d’essais des Landes,
Nicolas Grangier rejoint DGA Ingénierie de projets où il occupe des postes d’archi- tecte missile. Après un poste de directeur de programme Tigre, il rejoint l’AID lors de sa création.
Il a assuré la préfiguration puis la direction du service de la sécurité économique de la nouvelle direction de l’industrie de défense (DGA/DID)



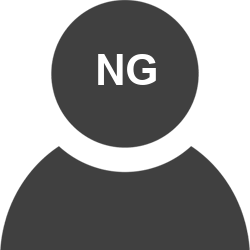





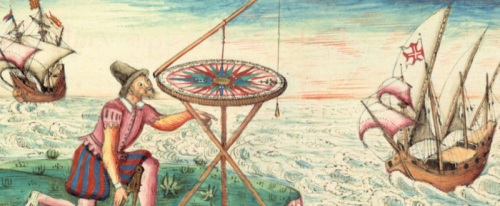



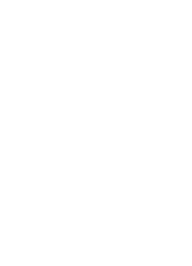
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.